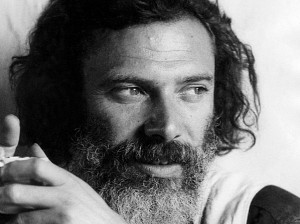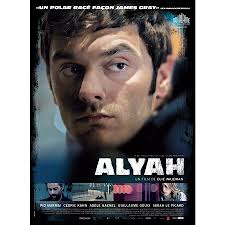Télécharger l’affiche
Présentation du livre L’homme Kertész par Nathalie Georges-Lambrichs à Ombres Bmanches le jeudi 24 avril 2014
Je remercie très vivement Christiane Terrisse de son invitation dans le Séminaire « Apprendre de l’artiste », qu’elle tient sous l’égide de l’ACF Midi-Pyrénées, ainsi que le délégué de l’ACF Eduardo Scarone pour sa présence. Christiane Alberti m’a priée de l’excuser de ne pouvoir être avec nous ce soir. Je vous dirai donc quelques mots à propos de L’homme Kertész, Variations psychanalytiques pour passer d’un siècle à un autre, paru l’an dernier dans la collection que Philippe Lacadée dirige aux éditions Michèle.
Christiane Terrisse travaille depuis plus de dix ans sur l’œuvre de Kertész. Avec son amie Yvette Goldberger-Joselzon, responsable de l’association franco-hongroise en Midi-Pyrénées, elle a rencontré Kertész en 2006 lorsque Jean-Quentin Châtelain a donné, en présence de l’auteur, la mémorable représentation de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, mis en scène par Joël Jouanneau – je dis « mémorable », car lorsque Kertész nous a reçues, Daniela Fernandez et moi-même en 2010 à Berlin où nous allions l’interviewer pour La Cause freudienne (vous trouverez la première version de cet entretien dans le n°77 de la revue, et une seconde dans le livre), Madga, sa femme, nous en parla avec une grande émotion.
Il m’importait de donner à ce livre une forme collective. Sans doute parce que depuis mon toujours à moi je cherche ce qui cause le désir d’écrire, et ce qui cause le désir de publier des livres, ce qui est encore autre chose. À l’ère des marchés, beaucoup s’indignent et déplorent ce que le livre devient, sa disparition mais aussi sa promotion, et nul ne sait ce qu’il adviendra de ce qui s’est appelé, depuis la Bible et jusqu’à Mallarmé Le Livre. Sans doute Le Livre n’existe pas, d’où sa profusion, son abondance et en même temps sa raréfaction. Ils pullulent, les livres, non sans que celui qui vous manque demeure le plus précieux. Il y a une érotique du livre, dont je ne sais si celle de l’écran plat est en passe de la remplacer. L’auteur, résorbé dans son texte, celui-ci rehaussé par un objet courant, vulgaire ou de grand luxe, c’est à chaque fois une équation, un tenant-lieu de la part d’éternité de chacun de nous, puisque la vie du livre est supposée durer plus longtemps que celle des êtres de chair, ce qui a peut-être changé. Pour ma part, qui sans doute croit encore trop au Livre, j’ai voulu me décompléter au moyen de chacun de nous en faisant résonner des textes de sources différentes, et créer encore du manque dans cette relative profusion de pistes pour aborder l’œuvre de Kertész.
C’est en amateur que j’ai abordé ses romans, et que je me suis intéressée aussi à sa personne, et surtout au style de vie qu’il a choisi et dont il a parlé.
C’est à partir d’un amour de la littérature qui fut tôt contrarié par la névrose que, depuis la psychanalyse qui tant me fut nécessaire pour assumer mon destin propre, je regarde la littérature, en lui demandant toujours pourquoi elle ne m’a pas suffi. Lorsque j’entends Kertész dire qu’elle l’a sauvé, que Thomas Mann mais aussi Albert Camus l’ont littéralement empêché de sombrer, je me demande quel est ce transfert qui, en occident, ne suffisait plus. Je sais bien que cette question est la mienne, et qu’elle est pour une part impartageable, mais je prends le risque de vous en faire part, pour savoir si elle résonne en vous, si elle vous parle, à vous qui êtes, chacune et chacun, sûrement des lecteurs et peut-être des amoureux de la littérature.
Pour moi qui suis née entre deux livres et quelques manuscrits, j’ai longtemps pensé ou éprouvé que la littérature exigeait tous les sacrifices et je me suis rebellée là contre. Protestation stupide, mais dont la stupidité était précisément le socle sur lequel ma carrière d’analysant allait se greffer. Ma question était si radicale et têtue que seule la psychanalyse pouvait l’accueillir. Étais-je vivante ou morte ? Mortifiée, sans doute, mais à quel degré et pourquoi ? Étais-je garçon ou fille, sans doute mais surtout, qu’est-ce que les cinq lettres qui composent le mot de fille garantissaient ou empêchaient ou favorisaient ? Le mystère était pour moi celui de la lettre, et il était lié à celui du sexe, de la vie et de la mort, par le pouvoir ou le maléfice du nom propre. C’est une question sur le pouvoir du nom qui m’a fait choisir par force la psychanalyse, et c’est la psychanalyse qui m’a, peu à peu, désanalphabêtisée.
Ce sont les points de butée de l’œuvre de Kertész, qui déteste son nom propre sans savoir pourquoi. Son nom est un nom juif maggyarisé et qui de plus, mais cela il ne le dit pas je crois, a une signification dans la langue hongroise. Cela suffit-il à expliquer cette détestation ? Manifestement Kertész n’a jamais mis en doute son identité anatomique. Manifestement son choix d’objet s’est porté sur les femmes, les belles femmes, et ce qu’il a pu confier de ses amours nous montre qu’il est passé d’une longue passion ravageante à un amour véritable. La question de la paternité, il l’a traitée dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Mais n’est-ce pas aussi celle de la maternité ? C’est l’un des points où, pour moi, loge le mystère. Ses enfants, ce sont ses livres, n’est-ce pas ? Et là où Freud situe la castration de l’individu par la prolongation de l’espèce, Kertész répond par la foi dans le produit le plus essentiel de la civilisation, à savoir le livre. Enfin, le désir qui est le sien est aussi le nôtre : aux quatre lettres du nom de juif, la marque de ce nom qui est aussi un adjectif, qui ont déterminé la matrice de son destin, il a répondu en arrachant à cette matrice du nouveau sous la forme de cette œuvre qui, profondément secrète et grandie dans la clandestinité quasi absolue, s’est soudain, à la faveur d’un changement politique, imposée au monde. Ce qui fait que Kertész a par deux fois fait l’expérience de ce qu’il a nommé l’échec, traduction du hongrois « fiasco » qui est dépourvu me dit-on de tout sens sexuel dans cette langue, ce pourquoi on n’a pu le conserver dans la traduction, alors que ke mot « holocauste », lui, a été conservé d’une langue à l’autre, pour la raison qu’il était le même, raison que nous pouvons peser en raison psychanalytique, car enfin, le mot de Shoah était déjà là, disponible, et qu’il ait été refusé par les traducteurs de Kertész n’a rien d’anodin, et éclaire au moins de biais que Kertész ait pu récemment déclarer que pour lui le Nobel était un échec encore plus cuisant que le refus qui frappa son premier manuscrit dans la Hongrie socialiste.
« Il n’est pas sûr que nous soyons débarrassés de l’idée sordide que la souffrance est bénie » écrit Alain Lercher dans le texte du recueil intitulé Prison du temps [1996 – Verdier], où, prenant prétexte des paradoxes qui caractérisent Ravenne (p. 93), son rayonnement, sa puissance, sa renommée et son déclin, il édite sur notre condition post-moderne. Plus hongrois que lui, István Bibó, dont je découvre l’importance grâce à Kertész qui le lit et le cite, a médité sur l’être hongrois, le caractère hongrois et les impasses. Si hongrois que sans doute son analyse permet d’isoler des concepts plus fondamentaux que ce trait national identitaire, comme l’être, le caractère et l’existence.
Kertész a donc passé sa vie d’écrivain en exclusion interne à la société hongroise des années 1948-1991, trouvant dans l’oppression intellectuelle qui y régnait les conditions du risque de sa liberté à l’épreuve de l’écriture. L’œuvre n’est que la pointe émergée d’une expérience personnelle impartageable. Elle est le témoin d’un double paradoxe : le prix d’une vie échappe à toute autre évaluation que celle que le sujet peut en donner lui-même, cette évaluation du sujet par lui-même est si partiale qu’elle n’emporte aucune nécessité d’y croire, ou plus exactement, qu’y croire est le pire que l’on puisse faire devant le témoignage. Aussi, par-delà la croyance qui a pour fondement l’identification, est-ce la force de l’exemple que Kertész ranime, à partir d’un savoir cru en son propre. Ce qui s’oppose au savoir c’est la croyance, qui repose sur le socle de l’ignorance. Le savoir est une conséquence. C’est là le miracle du désir : à savoir qu’un homme ayant survécu à la vérité du XXème siècle ait pu, mais surtout ait transformé sa faiblesse en force pour ressusciter son vouloir assumer sa condition d’homme ayant éprouvé dans sa chair et dans sa pensée ce pire que le nom d’Auschwitz indexe, cet homme existe. C’est lui que Daniela Fernandez et moi avons voulu rencontrer, un homme qui s’est voué à incarner la tension entre l’étranger et l’intime que Lacan a nommé l’extimité, et qui à partir de ce noyau dur, a dévolu sa vie à défendre son œuvre, et son œuvre à prolonger sa vie, à la dépasser. Incarner un compromis entre le plus intime et le plus général, entre l’individu et le collectif, quoi de plus freudien et donc de plus lacanien ? Kertész nous dit qu’il ne lit pas le français (encore que je le soupçonne d’en avoir quand même une certaine approche), mais il est un freudien véritable et sans doute le seul Nobel de littérature) avoir cité Freud.
Je vais donc vous lire maintenant le discours du Nobel, avant de rendre la parole à Christiane, Yvette, et votre assistance, dont la présence me dit que décidément, la passerelle entre littérature et psychanalyse existe, et qu’elle est bien fréquentée.
Discours d’Imre Kertesz à Stockholm 10 décembre 2002
Avant toute chose, je dois vous faire un aveu, un aveu peut-être étrange mais sincère. Depuis que je suis monté dans l’avion pour venir ici, à Stockholm, recevoir le prix Nobel qui m’a été décerné cette année, je sens dans mon dos le regard scrutateur d’un observateur impassible ; et en cet instant solennel qui me place au centre de l’attention générale, je m’identifie plutôt à ce témoin imperturbable qu’à l’écrivain soudain révélé au monde entier. Et j’espère seulement que le discours que je vais prononcer pour cette occasion m’aidera à mettre fin à cette dualité, à réunir ces deux personnes qui vivent en moi.
Pour l’instant, moi-même, je ne comprends pas assez clairement l’aporie que je sens entre cette haute distinction et mon œuvre, ou plutôt ma vie. J’ai peut-être vécu trop longtemps dans des dictatures, dans un environnement intellectuel hostile et désespérément étranger, pour pouvoir prendre conscience de mon éventuelle valeur littéraire : la question ne valait tout simplement pas la peine d’être posée. De surcroît, on me faisait comprendre de toutes parts que le “ sujet ” qui occupait mes pensées, qui m’habitait, était dépassé et inintéressant. Voilà pourquoi(,) j’ai toujours considéré l’écriture comme une affaire strictement privée, ce qui rejoignait d’ailleurs mes plus intimes convictions.
Dire qu’il s’agit d’une affaire privée n’exclut nullement le sérieux, même si ce dernier semblait quelque peu ridicule dans un monde où seul le mensonge était pris au sérieux. Or, l’axiome philosophique définissait le monde comme réalité existant indépendamment de nous. Mais moi, en 1955, par un beau jour de printemps, j’ai compris d’un coup qu’il n’existait qu’une seule réalité, et que cette réalité, c’était moi, ma vie, ce cadeau fragile et d’une durée incertaine que des puissances étrangères et inconnues s’étaient approprié, avaient nationalisé, déterminé et scellé, et j’ai su que je devais la reprendre à ce monstrueux Moloch qu’on appelle l’histoire, car elle n’appartenait qu’à moi et je devais en disposer en tant que telle.
En tout cas, cela m’opposait radicalement à tout ce qui m’entourait, à cette réalité qui n’était peut-être pas objective, mais certainement indéniable. Je parle de la Hongrie communiste, du socialisme qui promettait un avenir radieux. Si le monde est une réalité objective qui existe indépendamment de nous, alors l’individu n’est qu’un objet – y compris pour lui-même, et l’histoire de sa vie n’est qu’une suite incohérente de hasards historiques qu’il peut certes contempler, mais qui ne le concernent pas. Il ne lui sert à rien de les ordonner en un ensemble cohérent, car son moi subjectif ne saurait assumer la responsabilité des éléments trop objectifs qui pourraient s’y trouver.
Un an plus tard, en 1956, a éclaté la révolution hongroise. Pour un seul et bref instant, le pays est devenu subjectif. Mais les chars soviétiques ont bien vite rétabli l’objectivité.
S’il vous semble que je fais de l’ironie, alors pensez, je vous prie, à ce que sont devenus la langue et les mots au cours du 20e siècle. Selon moi, il est vraisemblable que la plus importante, la plus bouleversante découverte des écrivains de notre temps est que la langue, telle que nous l’avons héritée d’une culture ancienne, est tout simplement incapable de représenter les processus réels, les concepts autrefois simples. Pensez à Kafka, pensez à Orwell qui ont vu la langue ancienne fondre dans leurs mains, comme s’ils l’avaient mise au feu pour ensuite en montrer les cendres où apparaissaient des images nouvelles et jusqu’alors inconnues.
Mais je voudrais revenir à mon affaire strictement personnelle, c’est-à-dire à l’écriture. Il y a là quelques questions que tout homme dans ma situation ne se pose même pas. Jean-Paul Sartre, par exemple, a consacré tout un opuscule à la question de savoir pour qui on écrit. La question est intéressante, mais elle peut également être dangereuse et je suis en tout cas reconnaissant à la vie de n’avoir jamais eu à y réfléchir. Voyons en quoi consiste le danger. Par exemple, si on vise une classe sociale qu’on voudrait non seulement divertir mais aussi influencer, il faut avant tout prendre en considération son propre style et se demander s’il est adapté à l’objectif qu’on s’est fixé. L’écrivain est bientôt assailli de doutes : le problème est qu’il est dès lors occupé à s’observer lui-même. De plus, comment pourrait-il savoir quelles sont les vraies attentes de son public, ce qui lui plaît vraiment ? Il ne peut tout de même pas interroger chaque individu. D’ailleurs, cela ne servirait à rien. En définitive, son seul point de départ possible est l’idée qu’il a lui-même de son public, les exigences que lui-même lui attribue, l’effet qu’aura sur lui-même l’influence qu’il souhaite exercer. Pour qui donc l’écrivain écrit-il ? La réponse est évidente : pour lui-même.
Moi au moins, je peux dire que j’étais arrivé à cette réponse sans aucun détour. Il est vrai que mon cas était plus simple : je n’avais pas de public et ne voulais influencer personne. Je n’avais pas de but précis quand j’ai commencé à écrire et ce que j’écrivais ne s’adressait à personne. Si mon écriture n’avait pas d’objectif clairement exprimable, elle consistait néanmoins à garder une fidélité formelle et linguistique à mon sujet, rien d’autre. Il importait de le préciser à cette époque ridicule mais triste où la littérature dite engagée était dirigée par l’Etat.
Il m’aurait en revanche été plus difficile de répondre à la question, posée à juste titre et non sans un certain scepticisme, de savoir pourquoi on écrit. A nouveau, j’ai eu de la chance, car je n’ai jamais eu l’occasion de trancher cette question. J’ai d’ailleurs relaté fidèlement cet événement dans mon roman intitulé Le refus. Je me trouvais dans le couloir désert d’un immeuble administratif et j’entendais des pas résonner dans un couloir perpendiculaire, c’est tout. J’ai été pris d’une sorte d’agitation particulière, les pas venaient dans ma direction, c’étaient ceux d’une seule personne que je ne voyais pas, et brusquement, j’ai eu l’impression d’en entendre marcher des centaines de milliers, une véritable colonne dont les pas retentissaient et alors j’ai saisi la force d’attraction de ce défilé, de ces pas. Là, dans ce couloir, j’ai compris en une seule seconde l’ivresse de l’abandon de soi, le plaisir vertigineux de se fondre dans la masse, ce que Nietzsche – dans un autre contexte, certes, mais avec pertinence – nomme l’extase dionysiaque. Une force quasi physique me poussait et m’attirait dans les rangs, je sentais que je devais m’appuyer et m’aplatir contre le mur, pour ne pas céder à cette attraction.
Je rends compte de cet instant intense comme je l’ai vécu ; la source d’où il avait jailli telle une vision semblait se trouver en dehors de moi et non en moi-même. Tout artiste connaît de tels instants. Autrefois, on les s’appelait des inspirations soudaines. Mais je ne mettrais pas ce que j’ai vécu au nombre des expériences artistiques. Je parlerais plutôt d’une prise de conscience existentielle, laquelle ne m’a pas donné la maîtrise de mon art, car j’ai dû encore longtemps en chercher les outils, mais celle de ma vie, alors que je l’avais presque perdue. Il y était question de la solitude, d’une vie plus difficile, de ce dont j’ai parlé au début : il s’agissait de sortir du cortège enivrant, de l’histoire qui dépouille l’homme de sa personnalité et de son destin. J’avais constaté avec effroi que dix ans après être revenu des camps nazis et avec pour ainsi dire un pied dans la fascination de la terreur stalinienne, il ne me restait plus de tout cela qu’une vague impression et quelques anecdotes. Comme si c’était arrivé à quelqu’un d’autre.
Il est évident que ces instants visionnaires ont une longue histoire que Sigmund Freud déduirait peut-être du refoulement de quelque traumatisme. Qui sait, peut-être aurait-il raison. Or moi aussi, je penche plutôt pour la rationalité et suis loin de tout mysticisme ou enthousiasme : quand je parle de vision, j’entends une réalité qui a pris la forme du surnaturel – à savoir la révélation soudaine, on pourrait dire révolutionnaire, d’une idée qui mûrissait en moi, une chose qu’exprime l’antique exclamation “ eurêka ! ”. “ J’ai trouvé ! ” Certes, mais quoi ?
J’ai dit un jour que pour moi, ce qu’on appelle le socialisme avait la même signification qu’eut pour Marcel Proust la madeleine qui, trempée dans le thé, avait ressuscité en lui les saveurs du temps passé. Après la défaite de la révolution de 1956, j’ai décidé, essentiellement pour des raisons linguistiques, de rester en Hongrie. Ainsi j’ai pu observer, non plus en tant qu’enfant, mais avec ma tête d’adulte, le fonctionnement d’une dictature. J’ai vu comment un peuple est amené à nier ses idéaux, j’ai vu les débuts de l’adaptation, les gestes prudents, j’ai compris que l’espoir était un instrument du mal et que l’impératif catégorique de Kant, l’éthique, n’étaient que les valets dociles de la subsistance.
Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée voire décadente ? Dans les années soixante, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu’on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de “ communisme de goulache ” : après l’animosité du début, le communisme hongrois était devenu d’un coup le communisme préféré de l’Occident. Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu’une alternative : ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure. Un écrivain n’a pas de grands besoins, un crayon et du papier suffisent à l’exercice de son art. Le dégoût et la dépression avec lesquels je me réveillais chaque matin m’introduisaient vite dans le monde que je voulais décrire. Je me suis rendu compte que je décrivais un homme broyé par la logique d’un totalitarisme en vivant moi-même dans un autre totalitarisme, et cela a sans aucun doute fait de la langue de mon roman un moyen de communication suggestif. Si j’évalue en toute sincérité ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j’aurais été capable d’écrire le même roman que celui qui est connu aujourd’hui sous le titre d’Etre sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l’Académie Suédoise.
Non, car j’aurais certainement eu d’autres préoccupations. Je n’aurais certes pas renoncé à chercher la vérité, mais c’eût été peut-être une autre vérité. Dans le marché libre des livres et des esprits, je me serais peut-être efforcé de trouver une forme romanesque plus brillante : j’aurais pu, par exemple, fragmenter la narration pour ne raconter que les moments frappants. Sauf que dans les camps de concentration, mon héros ne vit pas son propre temps, puisqu’il est dépossédé de son temps, de sa langue, de sa personnalité. Il n’a pas de mémoire, il est dans l’instant. Si bien que le pauvre doit dépérir dans le piège morne de la linéarité et ne peut se libérer des détails pénibles. Au lieu d’une succession spectaculaire de grands moments tragiques, il doit vivre le tout, ce qui est pesant et offre peu de variété, comme la vie.
Mais cela m’a permis de tirer des enseignements étonnants. La linéarité exige que chaque situation s’accomplisse intégralement. Elle m’a interdit, par exemple, de sauter élégamment une vingtaine de minutes pour la seule raison que ces vingt minutes béaient devant moi tel un gouffre noir, inconnu et effrayant comme une fosse commune. Je parle de ces vingt minutes qui se sont écoulées sur le quai du camp d’extermination de Birkenau avant que les personnes descendues des wagons ne se retrouvent devant l’officier qui faisait la sélection. Moi-même, j’avais un souvenir approximatif de ces vingt minutes, mais le roman m’interdisait de me fier à mes réminiscences. Presque tous les témoignages, confessions et souvenirs de survivants que j’avais lus étaient d’accord sur le fait que tout s’était déroulé très vite et dans la plus grande confusion : les portes des wagons s’ouvraient violemment au milieu des cris et des aboiements, les hommes étaient séparés des femmes, dans une cohue démentielle ils se retrouvaient devant un officier qui leur jetait un rapide coup d’œil, montrait quelque chose en tendant le bras, puis ils se retrouvaient en tenue de prisonnier.
Moi, j’avais un autre souvenir de ces vingt minutes. En cherchant des sources authentiques, j’ai commencé par lire Tadeusz Borowski, ses récits limpides, d’une cruauté masochiste, dont celui qui s’intitule “ Au gaz, messieurs-dames ! ” Ensuite, j’ai eu entre les mains une série de photos qu’un SS avait prises sur le quai de Birkenau lors de l’arrivée des convois et que les soldats américains ont retrouvées à Dachau, dans l’ancienne caserne des SS. J’ai été sidéré par ces photos : beaux visages souriants de femmes, de jeunes hommes au regard intelligent, pleins de bonne volonté, prêts à coopérer. Alors j’ai compris comment et pourquoi ces vingt minutes humiliantes d’inaction et d’impuissance s’étaient estompées dans leur mémoire. Et quand en pensant que tout cela s’était répété jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, durant de longues années, j’ai pu entrevoir la technique de l’horreur, j’ai compris comment on pouvait retourner la nature humaine contre la vie humaine.
J’avançais ainsi, pas à pas, sur la voie linéaire des découvertes ; c’était, si on veut, ma méthode heuristique. J’ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pour quoi j’écrivais ne m’intéressaient pas. Une seule question me travaillait : qu’avais-je encore en commun avec la littérature ? Car il était clair qu’une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne – comme tant d’autres choses – s’appelle Auschwitz. Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. A propos d’Auschwitz, on ne peut écrire qu’un roman noir ou, sauf votre respect, un roman-feuilleton dont l’action commence à Auschwitz et dure jusqu’à nos jours. Je veux dire par là qu’il ne s’est rien passé depuis Auschwitz qui ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l’Holocauste n’a jamais pu apparaître au passé.
On dit à mon propos – pour m’en féliciter ou pour me le reprocher – que je suis l’écrivain d’un seul thème, l’Holocauste. Je ne trouve rien à y redire, pourquoi n’accepterais-je pas, avec quelques réserves, la place qui m’a été attribuée sur l’étagère idoine des bibliothèques ? En effet, quel écrivain aujourd’hui n’est pas un écrivain de l’Holocauste ? Je veux dire qu’il n’est pas nécessaire de choisir expressément l’Holocauste comme sujet pour remarquer la dissonance qui règne depuis des décennies dans l’art contemporain en Europe. De plus : il n’y a, à ma connaissance, pas d’art valable ou authentique où on ne sente pas la cassure qu’on éprouve en regardant le monde après une nuit de cauchemars, brisé et perplexe. Je n’ai jamais eu la tentation de considérer les questions relatives à l’Holocauste comme un conflit inextricable entre les Allemands et les Juifs ; je n’ai jamais cru que c’était l’un des chapitres du martyre juif qui succède logiquement aux épreuves précédentes ; je n’y ai jamais vu un déraillement soudain de l’histoire, un pogrome d’une ampleur plus importante que les autres ou encore les conditions de la fondation d’un Etat juif. Dans l’Holocauste, j’ai découvert la condition humaine, le terminus d’une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de deux mille ans de culture et de morale.
A présent il faut réfléchir au moyen d’aller plus loin. Le problème d’Auschwitz n’est pas de savoir s’il faut tirer un trait dessus ou non, si nous devons en garder la mémoire ou plutôt le jeter dans le tiroir approprié de l’histoire, s’il faut ériger des monuments aux millions de victimes et quel doit être ce monument. Le véritable problème d’Auschwitz est qu’il a eu lieu, et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. En parlant de “ scandale ”, le poète hongrois catholique János Pilinszky a sans doute trouvé la meilleure dénomination de ce pénible état de fait ; et par là, il voulait à l’évidence dire qu’Auschwitz a eu lieu dans la culture chrétienne et constitue ainsi pour un esprit métaphysique une plaie ouverte.
D’anciennes prophéties disent que Dieu est mort. Il ne fait aucun doute, qu’après Auschwitz, nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Il nous a fallu créer nos valeurs, jour après jour, par un travail éthique opiniâtre mais invisible qui finira par produire les valeurs qui donneront peut-être naissance à la nouvelle culture européenne. Que l’Académie Suédoise ait jugé bon de distinguer précisément mon œuvre prouve à mes yeux que l’Europe éprouve à nouveau le besoin que les survivants d’Auschwitz et de l’Holocauste lui rappellent l’expérience qu’ils ont été obligés d’acquérir. A mes yeux, permettez-moi de le dire, c’est une marque de courage, voire d’une certaine détermination ; car on a souhaité me voir venir ici tout en se doutant de ce que j’allais dire. Mais ce qui a été révélé à travers la solution finale et “ l’univers concentrationnaire ” ne peut pas prêter à confusion, et la seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices est de découvrir ce point zéro. Pourquoi cette lucidité ne serait-elle pas fertile ? Au fond des grandes découvertes, même si elles se fondent sur des tragédies extrêmes, réside toujours la plus admirable valeur européenne, à savoir le frémissement de la liberté qui confère à notre vie une certaine plus-value, une certaine richesse en nous faisant prendre conscience de la réalité de notre existence et de notre responsabilité envers celle-ci.
C’est pour moi une joie particulière de pouvoir exprimer ces pensées en hongrois, ma langue maternelle. Je suis né à Budapest, dans une famille juive, ma mère était originaire de Kolozsvár en Transylvanie, mon père, du sud-ouest du Balaton. Mes grands-parents allumaient encore les bougies le vendredi soir pour saluer le sabbat, mais ils avaient déjà changé leur nom pour lui donner une consonance hongroise et il était naturel pour eux d’avoir le judaïsme comme religion et de considérer la Hongrie comme leur patrie. Mes grands-parents maternels ont trouvé la mort durant l’Holocauste, mes grands-parents paternels ont été anéantis par le pouvoir communiste de Rákosi, après que la maison de retraite des Juifs a été transférée de Budapest vers la frontière du nord. Il me semble que cette brève histoire familiale résume et symbolise à la fois les souffrances récentes de ce pays. Tout cela m’apprend que le deuil ne recèle pas que de l’amertume, mais aussi des réserves morales extraordinaires. Etre juif : je pense qu’aujourd’hui, c’est redevenu avant tout un devoir moral. Si l’Holocauste a créé une culture – ce qui est incontestablement le cas – le but de celle-ci peut être seulement que la réalité irréparable enfante spirituellement la réparation, c’est-à-dire la catharsis. Ce désir a inspiré tout ce que j’ai jamais réalisé.
Bien que mon discours touche à sa fin, j’avoue sincèrement que je n’ai toujours pas trouvé d’équilibre apaisant entre ma vie, mon œuvre et le prix Nobel. Pour l’instant, je ne sens qu’une profonde reconnaissance – pour l’amour qui m’a sauvé et me maintient encore en vie. Mais admettons que dans le parcours à peine visible, la “ carrière ”, si j’ose m’exprimer ainsi, qui est la mienne, il y a quelque chose de troublant, d’absurde ; une chose qu’on peut difficilement penser sans être tenté de croire en un ordre surnaturel, une providence, une justice métaphysique, c’est-à-dire sans se leurrer, et donc s’engager dans une impasse, se détruire et perdre le contact profond et douloureux avec les millions d’êtres qui sont morts et n’ont jamais connu la miséricorde. Il n’est pas simple d’être une exception ; et si le sort a fait de nous des exceptions, il faut se résigner à l’ordre absurde du hasard qui, pareil aux caprices d’un peloton d’exécution, règne sur nos vies soumises à des puissances inhumaines et à de terribles dictatures.
Pourtant, pendant que je préparais ce discours, il m’est arrivé une chose très étrange qui, en un certain sens, m’a rendu ma sérénité. Un jour, j’ai reçu par la poste une grande enveloppe en papier kraft. Elle m’avait été envoyée par le directeur du mémorial de Buchenwald, M. Volkhard Knigge. Il avait joint à ses cordiales félicitations une autre enveloppe, plus petite, dont il précisait le contenu, pour le cas où je n’aurais pas la force de l’affronter. A l’intérieur, il y avait une copie du registre journalier des détenus du 18 février 1945. Dans la colonne “ Abgänge ”, c’est-à-dire “ pertes ”, j’ai appris la mort du détenu numéro soixante-quatre mille neuf cent vingt et un, Imre Kertész, né en 1927, juif, ouvrier. Les deux données fausses, à savoir ma date de naissance et ma profession, s’expliquent par le fait que lors de leur enregistrement par l’administration du camp de concentration de Buchenwald, je m’étais vieilli de deux ans pour ne pas être mis parmi les enfants et avais prétendu être ouvrier plutôt que lycéen pour paraître plus utile.
Je suis donc mort une fois pour pouvoir continuer à vivre – et c’est peut-être là ma véritable histoire. Puisque c’est ainsi, je dédie mon œuvre née de la mort de cet enfant aux millions de morts et à tous ceux qui se souviennent encore de ces morts. Mais comme en définitive il s’agit de littérature, d’une littérature qui est aussi, selon l’argumentation de votre Académie, un acte de témoignage, peut-être sera-t-elle utile à l’avenir, et si j’écoutais mon cœur, je dirais même plus : elle servira l’avenir. Car j’ai l’impression qu’en pensant à l’effet traumatisant d’Auschwitz, je touche les questions fondamentales de la vitalité et de la créativité humaines ; et en pensant ainsi à Auschwitz, d’une manière peut-être paradoxale, je pense plutôt à l’avenir qu’au passé.
Imre Kertesz traduction : Natalia et Charles Zaremba